A l'occasion du 39 ème anniversaire du décès le 11/07/1981, de mon père Ahmed LEMLIH, enterré au cimetière des martyrs de Rabat, voici un extrait de mon 3 ème roman autobiographique intitulé : Culottes fatales et djihad de camembert publié hier à Paris . (l'extrait est celui du premier jet c'est-à-dire que celui publié a été un peu revu)
La première partie de l'ouvrage relate comment un petit enfant descendu de l'Atlas voit sa vie basculer totalement. Assis, sur une caisse de vin vide sous le comptoir de la boutique de papa j'admirais les culottes des nombreuses Françaises clientes... Je vis celle de Nicole Billard. Elle me vit, trouva beaux mes yeux verts et dit à papa de m'envoyer chez elle. Non dans son lit, mais à l'école. Elle était institutrice et son mari était directeur de l'Ecole Européenne du Camp Mangin (Quartier militaire au Guéliz à Marrakech).
18
Arrivés en face
de notre douar, à ces ruines d'Oabel, sur l’autre flanc du ravin, nous fîmes
obligeamment halte. Papa s’assit sur un gros caillou. Il avait un très lourd
kilométrage de marche à pieds au compteur. Mais il avait dépassé la
cinquantaine. Il eut des larmes aux yeux en me racontant que lorsqu'il avait
mon âge, son père avait été obligé de rester chez lui un mois en attendant que
sa mère, mon arrière-grand-mère, et sa femme, ma grand-mère, finissent le
tissage de son vêtement ! Quand il me racontait cela, le vent soufflait
une complainte lugubre entre les arganiers et les rochers aux arrêtes pointues.
De Tagadirt, la
fumée montait bien droit quelques mètres puis tournait en une espèce de points
d’interrogation, avant d’être emportée et dissoute doucement par le vent dans
la grande vallée. Le douar était couvert d’une buée chaude. Aucun bruit ne nous
parvenait. Cependant, la vallée allait en se rétrécissant.
Regardant sur
l’autre flanc, au-dessus de la profonde gorge rocheuse, papa se tut lorsque nous
vîmes une foule à l’entrée de notre
maison. Comme le soleil était derrière nous, il éclairait splendidement devant
nous tel un monumental projecteur. Au fil des secondes, ma tension et mon
inquiétude s’étaient amplifiées. Mon cœur soufflait entre le chaud et le froid.
J’ouvrais grands les yeux. Les obscurs attraits de notre douar s’étaient
rapidement évanouis.
Papa
cria : « Mon cinquième fils est mort ! ». En effet,
l’attroupement des gens ressemblait à s’y méprendre, à un enterrement ;
mais plutôt chrétien car c’était le noir qui dominait chez notre gente féminine.
Et tout le monde était musulman. Je me mis à pleurer pendant que mon géniteur
essayait de comprendre ou d’imaginer la raison de l’attroupement. Je voulais
sauter sur l’autre flanc de la vallée à travers la très profonde gorge qui nous
séparait de notre douar.
La profondeur
de ce précipice dépasse nettement les trois cents mètres. Au fond coule une
petite rivière. Nous étions tout au bord du ravin. Une simple perte d’équilibre
et c’était la mort assurée au bout d’une chute du haut de ce qui est comme cent
étages. Les granits pointus, les basaltes coupants et les divers morceaux de
porphyres, se dressaient méchamment autour de nous. Nous nous
demandions si le petit était mort. Le vent
répondait : « Peut-être ! Peut-être ! ». Un vol
de corbeaux passa, nous rasa et s’enfonça dans les profondeurs.
Papa sembla
entendre à son oreille : « Te voici encore puni pour tous les
péchés que tu as commis en France où tu as bu du vin et mangé du porc et
commis l’adultère! ». Des larmes acides mouillaient ses
yeux. « O Allah ! Pardonne-moi ! Je sais que j’ai
pêché ! Mais pardonne-moi, je suis faible ! » Dit-il en
s’asseyant sur une autre grosse pierre juste un laps de temps avant de se lever
en hâte, comme si le caillou était brûlant. Quelqu’un dans Tagadirt, nous
faisais signe de ses mains. Mais, séparés par le profond précipice et à près de
deux cents mètres nous ne pouvions pas reconnaître la personne ni comprendre ce
qu’elle voulait dire, encore moins l’entendre.
- Ce n’est pas un baptême car ça fait des mois
que mon fils est né ! – Ma femme est seule à la maison avec le bébé… Les
gens n’ont rien à voir ! – Elle ne peut pas organiser une réception car
elle ignore que nous allons venir ! – Mon frère ne peut pas faire la fête
dans ma maison car il a celle de nos parents et la sienne toute neuve en dehors
du douar ! – La vache de ma femme ne peut pas avoir donné naissance à un
être bizarre ou à plusieurs veaux à la fois ! – L’âne de la famille ne
peut pas avoir attiré la foule. S’il était enragé, on l’aurait simplement
poussé par-dessus la falaise ! Tous les rochers et les murs sont à leurs
places…
Dans la tête de
papa il y avait un abominable cirque et point d’explication, que des hypothèses
dures à admettre. Ahmed se rappela le précepte fondamental de Sherlock
Holmes : « Quand toutes les hypothèses vraisemblables ont été
écartées, et quand il ne reste qu’une seule solution, si invraisemblable
soit-elle, alors cette idée folle s’appelle la vérité ! », pensa papa
en se disant, tout en pleurs : « Mon fils est mort ! C’est
sûr et c’est la vérité !... J’aurais dû… J’aurais dû emmener ta mère à
Marrakech pour qu’elle y accouche, là-bas y a des hôpitaux et des médecins ! ».
- Non papa ! Mon frère n’est pas du tout
mort ! Criai-je.
- Je voudrais
bien me tromper mon petit ! Murmura-t-il abattu, et il ajouta, d’une voix
gutturale, le visage figé dans une expression anéantie : « Et
cette foule devant notre maison !? Pourquoi tant de gens !? ».
Un frisson me
parcourra l’échine. J’avançais à grandes enjambées en pleurant. Plusieurs fois,
je tombais à la renverse, me relevais en tenant bien ma petite valise. Mon beau
paysage natal devint menaçant. Mes yeux sentaient avec douleur le monumental et
horrible rocher du douar avec ses arrêtes effilées comme découpées par un
couteau. Ce n’était pas un rocher, c’étaient des ovins et des bovins sans peau
pendus avec leur sang à une corde invisible. La corde du destin.
Nous dévalions
la montagne, pleins de stupéfaction et d’anéantissement. Nous descendions la
pente raide comme si nous étions poursuivis par une énorme bête sauvage. Au
milieu de la rocaille, des grosses pierres et des moellons, je tombais
plusieurs fois. Mon père se faisait, lui aussi mal. Il marchait et respirait
dans la souffrance comme si quelqu’un le poursuivait avec un fouet. Jamais je
ne levais les yeux vers les crêtes rocheuses et chancelantes. Nous marchions
péniblement dans la caillasse.
Pleins de
poussière et d’égratignures, nous arrivâmes à la petite rivière. L’eau était
très glacée. Je voulus boire rien qu’une petite gorgée d’eau fraîche, mais papa
me tira par la main pour traverser vite le cours d’eau. Dans l’état d’esprit
qui était le nôtre, rien ne pouvait nous pousser à nous reposer. La peine nous
fouettait, la douleur nous fouaillait.
Nous longeâmes
une horrible paroi rocheuse grisâtre en n’entendant rien d’autre que les bruits
des cailloux piétinés. Juste à côté de nous et dans de petits vergers clôturés
au bord de l’eau, des femmes bêchaient, sarclaient et arrosaient les plantes.
Elles semblaient ne pas nous avoir vus car tout le monde se connaissait dans
les environs.
Un petit pique-bœuf
épouillait consciencieusement un bœuf couché non loin de notre chemin. Deux
autres pique-bœufs poursuivaient un petit troupeau de moutons et de chèvres. Jamais je n’avais vu mon père courir de cette
façon : comme un fou qui court derrière quelque chose de perdu. On
entendait le hurlement funeste du vent et le grondement sourd de nos cœurs.
Nous ne
sentîmes pas le parfum des roches mouillées, ni de la paille qui commençait à
pourrir en ce début d’hiver. Les nénuphars de la rivière m’apparaissaient comme
de grandes tâches de sang noircies par le temps. La terreur nous empêchait
d’articuler quoi que ce soit. Je tremblais comme une feuille et nos souffles
étaient à bout. Nous étions dans un épuisement émotionnel total jamais vécu
auparavant.
On aurait dit
qu’on se dépêchait pour empêcher l’âme de mon frère de partir, pour lui dire
qu’il ne fallait pas partir car il y avait un avenir radieux qui l’attendait
dans la grande et fertile plaine. Papa respirait difficilement. J’étais plein
de poussière et de sang comme si je sortais d’une grosse bagarre. Les coups
terribles que recevaient nos cœurs étaient insupportables.
Au tournant,
juste avant de monter au douar, on aurait cru entendre de la musique métallique
gnaoua. Mais c’était un mulet ferré qui battait contre les cailloux. En arrivant à côté de nous, au niveau du
muret écroulé d’une terrasse, l’homme qui chevauchait arrêta sa monture. Il
l’attacha par la bribe à un arbre rabougri. Rapidement, il se dirigea vers
nous, baisa la main de papa et dit :
- Salut tonton ! Voulez-vous monter le
mulet pour le reste du chemin ? Dit-il timidement en souriant.
- Non ! Merci fiston, nous sommes
presque arrivés, nous n’avons plus qu’à monter ce chemin !
Emmitouflé, le
capuchon, de sa djellaba rabattu sur sa tête, mon cousin lointain courut
reprendre sa monture qui s’était éloignée un peu en rompant vite son entrave.
Un troupeau de chèvres et de moutons paissait entre les rochers de la montée.
Une fumée blanche se traînait paresseusement dans l’air lumineux en haut. Elle
ne semblait pas affecter la pureté de l’air.
Avant de monter
la pente raide, nous passâmes à côté de la margelle du puits au flanc du douar
de Tagadirt. Presque étourdi de soif, je n’osais pas demander à papa de nous
arrêter pour boire à un récipient plein d’eau que je frôlais en montant.
Rien ne
semblait vivant autour du puits. Seul le sifflement d’une sorte de moineau
troubla l’air. Deux trilles au loin et un corbeau au-dessus de nous, lui
répondirent. Puis, fatigués, ou sans doute rendormis, les oiseaux se turent. De
nouveau, ce fut le calme mortel pendant de longues et nombreuses minutes.
Nous n’étions
pas désespérés, nous étions accablés et fouettés par la douleur. Le vent nous
giflait, les cactus nous piquaient et les pierres nous lapidaient.
– Allah ! Toi, le Miséricordieux !
Ne me laisse pas dans la désolation et le malheur ! Pardonne-moi mes
péchés ! Fais que mon fils ne soit pas mort et que la foule devant chez
moi ne soit qu’une illusion ! Dit mon père les larmes aux yeux.
Un énorme
rocher se tenait menaçant au-dessus de nos têtes. Couleur de chair morte et
vidée de son sang, il semblait bouger. Mais c’était un gros nuage qui, passant,
donnait cette impression de mobilité à la rocaille. Terriblement malheureux, je
voyais mal le monde autour de moi. L’automne empiétant sur l’hiver, couvrait le
sentier d’un manteau de feuilles mortes qui voltigeaient telle une peau de
serpent.
En grimpant,
les yeux gonflés de larmes, je voyais les nombreux arganiers et les figuiers de
Barbarie devenir d’un vert bizarre. On aurait dit une purée d’épinards mélangée
à du sirop de grenadine. Nous étions accueillis par le chien de mon oncle qui
tentait de nous lécher les pieds et remuait la queue en signe de bienvenue et
comme pour nous tranquilliser.
Longtemps
après, j’allais enfin comprendre que lorsqu’un chien bouge sa queue en tentant
de lécher, c’est qu’il n’y a pas eu de mort, surtout pas d’un enfant.
Arrivés, haletant
bruyamment et complètement à bout de forces, à Tagadirt, nous avions des
battements de cœur à leur paroxysme. Des bruits lugubres retentissaient dans
nos oreilles. Les rochers nous masquaient brutalement tout. Notre respiration
était à bout.
Mon oncle vint
vite nous accueillir. Les larmes mouillaient toujours nos joues ; la peur
nous taraudait. Un court instant, le vent fléchit comme pour nous laisser le
silence afin de découvrir la terrible perte.
- Vous l’avez
déjà enterré ? Sans même que je le voie ! Lança papa d’une pâleur
extrême et sur un ton où la douleur se mélangeait à la colère. Nous étions pleins
de poussière et moi d’égratignures.
- Enterré qui ? Répondit mon oncle sur un
ton de parfaite surprise. Il avait les yeux tout ronds et semblait se demander
si son frère et son neveu n’étaient pas devenus fous. « En ces temps
difficiles et troublés tout est possible ! Ahmed était revenu de France
normal ! Mais, maintenant avec tous ces événements de l’indépendance,
c’est plus dur de ne pas perdre sa tête ! » Se dit-il enfin.
- Mais… Mon fils, le bébé… Il est bien
mort ?! N’est-ce pas ?! Il lança un regard inquisiteur tel que jamais
je ne l’avais vu. Il regarda fixement immobile comme s’il craignait que le
monde ne s’écroule autour de lui.
- Qui t’a dit qu’il est mort ? Il est
vivant et en bonne santé ! Dit mon oncle et notre douloureuse angoisse tentait
de se muer en perplexité.
- Il n’est pas mort ? Mais cette foule
devant la maison que nous avons bien vue d’Okhrib Oabel ? Pourquoi tous
ces gens ? Demanda papa sans se tranquilliser vraiment. Lorsqu’il vit son
frère sourire, il se mit en colère et dit : « Tu es bien
content, toi, avec tes quatre garçons ! Et moi un seul !...
Dis-moi ! Vous l’avez déjà enterré comme mon premier garçon Mohamed et mes
deux jumeaux Lahcen et Lhocine que je n’ai jamais vus ? » Demanda
Ahmed alors que sa voix flanchait. Il voulut en vain se racler la gorge.
- Je te répète que ton fils n’est pas
mort ! Viens le voir ! Dit mon oncle à son frère en lui prenant la
main. Il y avait chez lui une de ces franchises qui n’invitait pas du tout au
soupçon. Papa était tout silencieux. Pétrifié. Je tentais de supporter les
émotions qui m’habitaient. J’étais dans le même état que mon père. « Mon
frère n’est donc pas mort !? » Me dis-je en me délectant de joie en
entendant l’échange entre papa et tonton tout en approchant de l’entrée de
notre douar.
Un peu avant,
un vieil arganier exhibait fièrement sa chevelure frisée avec des tâches
verdâtres. Il était curieusement et totalement immobile même exposé au vent,
au-dessus du grand rocher de Tagadirt et au milieu de notre immense vallée. On aurait dit que cet arbre aussi était figé
par la surprise. Le douar sentait la roche et les plantes médicinales. Les
chiens aboyaient un peu trop fort, comme s’ils avaient senti un tremblement de
terre imminent.
Derrière la
muraille du douar, surgit un ânier étranger. C’était un marchand ambulant. On
appelait « arabe » ce genre d’étranger au douar. Il vendait divers
objets notamment des amulettes et des maquillages pour les femmes et parfois
des épices. Nous regardâmes autour de nous. Rien n’avait changé. Les montagnes
sont restées identiques et impassibles. Le ciel était très beau.
Nous entrâmes
rapidement. La grande porte en bois cloutée de notre maison était ouverte mais
personne ne pleurait. Je sentis tout de suite l’odeur familière qui n’avait pas
changé durant ma longue absence. Elle
groupait celle du foin et des animaux domestiques du rez-de-chaussée et celle
du premier étage où vivait ma mère avec son bébé.
Remontant en
hâte l’escalier, nous entendions les cris de mon petit frère. Ils nous parvenaient
avec une force inextinguible. Il semblait nous
crier : « Détrompez-vous je suis bien vivant ! ». Ses
cris couvraient complètement la voix de Radio Maroc qui sortait de notre poste
TSF.
19
Je vis alors
mon petit frère dans notre nouveau salon. Emmailloté dans une très longue
sangle plate de tissu blanc, le bébé avait l’air d’une petite momie posée sur
le tapis. Maman baisa la main de son mari puis sourit. Je me tins coi. J’avais
l’impression que mes neurones étaient en surchauffe. Pour se faire belle, ma
mère utilisait juste le k’hol, une poudre noire pour les yeux. Celle-ci allait
vite être interdite car des femmes, dit-on, l’auraient utilisée pour
empoisonner des personnes.
- Détache-le ! Je ne vais pas prendre dans
mes bras un paquet très bien ficelé ! Dit Ahmed à sa femme. Mais dès que
papa le prit avec ses petites mains libres, il nous sourit et griffa son
géniteur.
- Le malin, il a juste quelques mois et il
griffe déjà ! Comme ça je vais avoir moi aussi les égratignures que ton
frère s’est faites en tombant plusieurs fois sur le chemin… Car nous courions
comme des fous ! Nous avions cru que tu étais mort !
Lorsque l’imam
de Tagadirt arriva pour saluer mon père,
ma mère s’éclipsa en nous laissant avec le bébé. La vache de maman beugla et
l’âne braya comme pour nous souhaiter la bienvenue. Mon oncle remonta pour nous
rejoindre.
Nous étions
dans le nouveau salon récemment construit et bien fini avec des peintures
multicolores. Il occupait le coin nord-est au premier étage de la maison,
au-dessus de la falaise. Des fenêtres des deux côtés, on avait une vue
complètement dégagée sur de très beaux paysages. Au nord nous avions toute la
grande vallée avec au fond, à l’horizon,
les cimes neigeuses de la chaîne du Grand Atlas. Un air pur et frais soufflait.
J’en avalais sans modération des chapelets infinis de litres. La douleur d’il y
avait peu, laissait place à une véritable joie de vivre. J’entendis gargouiller
mon ventre.
- Ahmed, tu
parles de mort, pourquoi ? demanda mon oncle M’hamed d’une voix qui
trahissait son exaspération.
- Je t’ai dit que lorsque nous sommes arrivés
sur l’autre versant en face du douar, et à côté des ruines d’Oabel, nous avons
vu une foule à l’entrée de la maison. Pourquoi cette foule ? Et pourquoi
nous avons entendu en arrivant : « Tikzinte ghi
guenna ! (la chienne est au ciel) Est-ce qu’une chienne du douar est
morte ou quoi ?
- Les gens de Tagadirt sont venus écouter Radio
Maroc qui parle dans leur tachelhite (parler amazigh) sur le poste TSF que tu
as apporté avec toi la dernière fois ! Ils ont entendu que les Russes ont
envoyé une chienne dans le ciel, et tout le monde s’intéresse à cette chienne
au-dessus de nos têtes ! Dit mon oncle en riant.
- La Radio ment ! Les Russes ne peuvent
pas envoyer un chien, encore moins une chienne dans le ciel qui est le royaume
d’Allah ! Ils ne peuvent pas nous faire ça ! Ils l’ont seulement
lancée sur la lune pour l’empêcher de continuer à briller et pousser les
Musulmans à ne pas prier et à ne pas faire ramadan ! Dit l’imam en
essayant d’ouvrir grands ses yeux de
loup. Papa sortit une enveloppe et la lui remit.
Comme la
plupart des religieux musulmans, notre imam avait en horreur tous les animaux
surtout le chien, l’âne et la vache. Originaire d’une tribu voisine aussi
fauchée que les blés au mois d’août, il adorait l’argent plus que tout. Il
avait fait ses études dans une école coranique de la région. Marié et père de
deux enfants, il laissait son épouse aider ses parents à lui et venait occuper
le poste d’imam dans notre douar....
_____________________________________________________ 24 ans après, alors que l'indépendance arrivait à l'âge adulte, tout en laissant le pouvoir dans l'adolescence, papa fut un des très rares musulmans à continuer de vendre les alcools. Mais comme la vie passe vite, il arriva à 76 ans... Quelques mois avant sa fin il déclara:"Y a une pluie d'argent dans le magasin". En effet, il n'arrivait plus à bien compter les recettes qui remplissaient de gros sacs de farine vides.
Il mourut donc à Rabat le 11/07/1981 entre les mains de feu le fameux docteur Abdelkrim El Khatib et fut enterré au cimetière des martyrs... Allah irahmou ! Qu'il repose en paix heureux d'avoir bien vécu sans exploiter des humains ni les voler ni les tromper, ni leur vendre des mensonges !
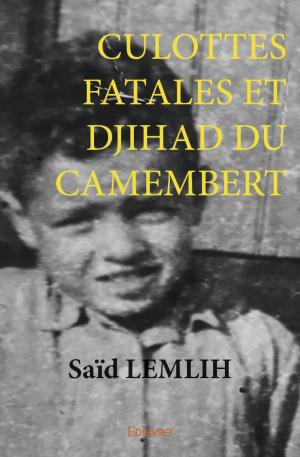
Pour avoir ce roman en papier ou en numérique, tapez le titre sur Google ou bien voici ci-dessous le lien:
https://www.edilivre.com/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire